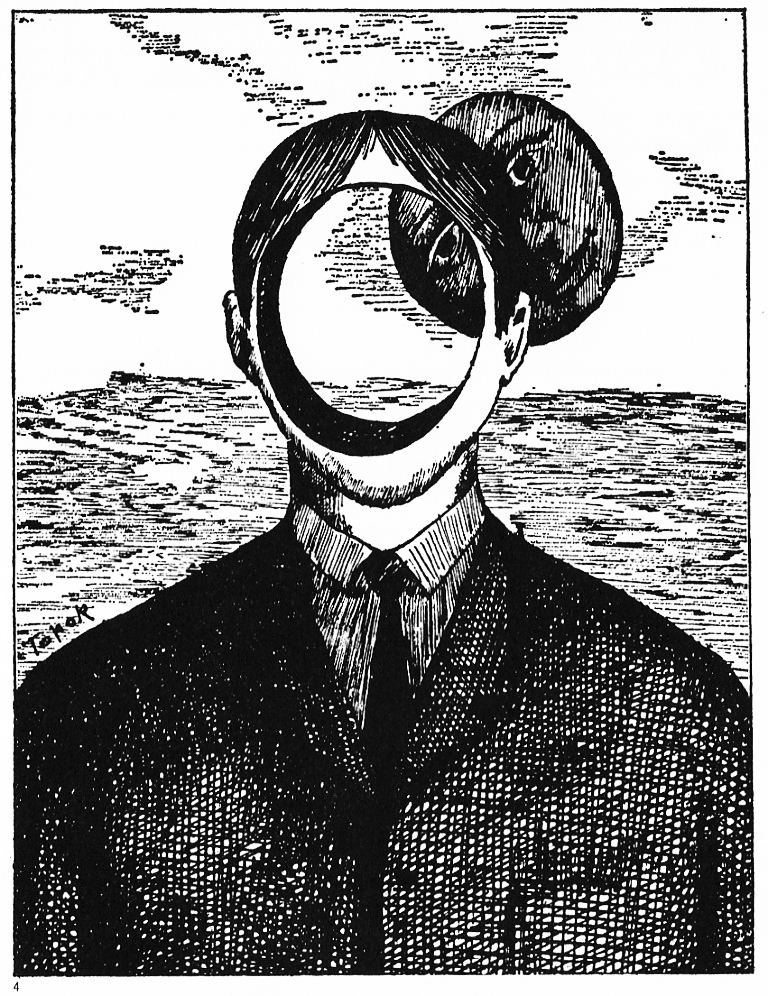La compagnie Moebius fait partie des derniers collectifs issus de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique) de Montpellier. Sous la direction d’Ariel Garcia-Valdès (qui a laissé sa place à Richard Mitou puis à Gildas Milin), ils ont eut la possibilité de travailler sur des créations originales avec des metteurs en scène très divers, d’Yves Ferry à Cyril Teste. La rencontre avec ce dernier leur a permis de démarrer la création d’œuvres originales, de dramaturgies de plateau avec metteur·euse en scène tournant d’un projet à l’autre. De la lignée des Atrides à la filiation, des rapports sociaux oscillant entre intime et politique, leur dernière création : Pharmakos livre une fable très aboutie en péripéties, qui réussit à sidérer tout en provocant la réflexion. Dans un rapport au public libéré des carcans de la séduction tout autant que son corolaire agressif de l’injure, le spectacle se monte comme un puzzle (ou un roman policier) autour de la construction d’une pièce de théâtre, de la construction d’un système social, de la construction d’une malversation financière.
Entretien avec le metteur en scène, juste avant la reprise de la tournée à la Scène Conventionnée pour les écritures contemporaines de Sortie Ouest.

Inferno : D’où vient la compagnie, et votre dernier projet ?
La compagnie s’est constituée à l’issue du ENSAD* de Montpellier en 2008. Très vite on s’est fédéré autour de la question de la tragédie. J’ai envie de dire que la compagnie, dès le début, a exploré la notion de tragédie et la notion de collectif. On est un collectif qui cherche toujours à définir ce qu’est un collectif. Les règles sont toujours un moyen de fonctionner en attendant que ça évolue. Avec les compétences de chacun, tout le monde met la main à la patte, on a réussit à faire face grâce aux forces vives différentes. Au début l’accent était mis très fort sur l’idée de faire exister la compagnie en tant que telle. Aujourd’hui, huit ans après, la notion s’est déplacée graduellement sur l’artistique : créer collectivement, est-ce que ça existe, comment ça nous déplace ? Et donc la question du propos : est-ce qu’on peut tenir un propos collectivement parlant ?
Il y a quelque chose qui nous regroupe mais ça n’empêche pas les sensibilités, les intelligences, les aspirations différentes. Très vite on était tous d’accord que les esthétiques pouvaient être très différentes d’un projet à l’autre. Il fallait qu’un meneur, un chef, soit garant d’un projet à l’autre. A ce jour, on a quatre projets collectifs qui sont des projets pensés pour le groupe et qui sont nécessairement dans un processus long. Il y a aussi les projets satellites qui sont des projets personnels liés à un membre de la compagnie pour une forme plus personnelle, qui peut se démarquer totalement de ce que sont les projets Moebius. Il y a eu trois metteurs en scène différents sur les quatre projets. Je peux d’ailleurs parler ici en tant que membre du collectif mais pas au nom du collectif. En tant que metteur en scène des deux derniers projets, qui sont les deux projets où on a décidé de passer le cap de l’écriture, la façon dont je me suis positionné était en tant que coordinateur de la recherche et en essayant de retarder le dernier moment où je vais devoir coiffer ma casquette de metteur en scène. Le résultat doit être l’émergence d’un travail de groupe.
Quel est votre méthode de travail ? Sur Pharmakos, quel à été le processus d’écriture s’il est différent des trois précédents projets ?
On n’a pas encore de méthode arrêtée. Comment inventer des outils collectifs d’écriture ? Chacun des projets est l’occasion pour nous d’une expérimentation réelle. Je me place toujours au-delà de ce que je connais déjà. Je suis toujours dans l’expérimentation même si on est pétri de notre savoir faire et de nos expériences. Quand on commence un travail, je ne sais jamais à quelle forme on aboutira. Quel statut aura l’acteur, la parole etc.
J’essai de schématiser pour être un peu clair :
Premièrement on voulait parler du bouc émissaire. C’est en lien direct avec les questions de la tragédie et ça peut faire écho à des tas de choses qu’on perçoit du monde qui nous entoure aujourd’hui. On s’est intéressé aux textes de Bernard Stiegler*. Il pense que cette tendance du bouc émissaire est très représentative du Front National. Quand on fait des recherches sur le sujet on arrive très très vite à René Girard qui a construit sa pensée sur le thème du bouc émissaire. Cette pensée m’a accompagné tout du long de la création. Les deux piliers de la théorie de Girard sont la notion du bouc émissaire et le désir mimétique*. Ces deux piliers englobent toute l’histoire de l’humanité sur beaucoup de points. Pour lui, les mythes sont le récit transformé de quelque chose qui a réellement eu lieu, qui s’est produit. Pour lui, il y a un faisceau d’indice tel que ça emporte sa conviction. Ce qui est caché derrière chaque mythe, c’est une question de meurtre collectif. Un groupe humain qui se raconte sa propre naissance. Il y a toujours un récit où il y a eu une persécution de la minorité. Un meurtre qui a déjà eu lieu avant la mémoire et où tout vient de là. C’est une boucle qui revient aux origines. Et de l’autre côté, il explique sa notion du désir mimétique. Qu’est ce qu’il y a dans nos mécanismes profond de désir et de rivalité ? On ne se définit que par rapport à l’autre, en fonction de nos appartenances, dans un mimétisme ou une rivalité, par nécessité d’être.
On est condamné à être quelqu’un. On ne peut pas être personne. Etre quelqu’un, de façon très triviale, quand on te demande qui tu es, on se définit par son rôle social, ses cercles, son nom de famille… Les personnages dans ce spectacle s’autodéterminent les uns par rapport aux autres. C’est aussi une société professionnelle qui s’écrit, pour en revenir à la question de la violence.
En travaillant sur René Girard, pour resserrer, on a pris un chapitre très précis dans son livre Le Bouc Emissaire* qui s’appelle la Décollation de St Jean Baptiste. Ce mythe-là proposait une structure claire et faisait échos à nos questions. Les rivalités fraternelles ou la mise à mort sont les archétypes qu’on retrouve dans tous les grands mythes. Une fois pris ces grands mythes, on a défini des règles d’improvisations. C’était tout simplement : deux comédiens se parlent et réfléchissent ensemble sans définir les enjeux ou incarner des rôles. Je commence en disant : je suis Hérode et on va discuter ensemble. Comme on sait ce qui se passe dans le mythe, on discute de notre point de vue sur ce qui va se passer. Et on enregistre toutes les improvisations possibles à deux, à trois, à tous etc. Il y a une règle : tout ce qui est dit fait autorité. C’était une grosse première couche de travail à partir de laquelle on a pu réécrire. On a passé deux cessions de quinze jours entre autre là-dessus.
Ensuite il y a tout un travail sur le prologue. La seule option qui nous sembler être viable c’était de montrer comment se constitue le groupe indépendamment de toute étiquette reconnaissable. Là, ça nait d’une fuite d’eau. Comment résoudre ce problème, comment on se retrouve de fait à rencontrer les autres autour d’un problème concret. La narration se déclenche et il faut lui donner chair et consistance. Un membre a plus spécifiquement travaillé l’écriture, à reprendre les improvisations pour sortir de l’oralité. Il fallait qu’il y ait un pas plus franc qui se fasse vers une écriture. Il y a un travail de scène très concret qui s’est fait entre quelqu’un qui écrit et une équipe d’acteurs. Et puis, finalement, la fiction se casse la gueule et il y a un nouvel appauvrissement de la langue. Il y a une sorte de dérision du retour à la fiction qui se re-délite. Ca n’a plus de portée, il faut re-déconstruire les choses. C’est un cycle cosmogonique, une fois que la mise à mort est faite, on oublie la mémoire et on peut repartir.
Est-ce que tout fini forcement par un assassinat ?
Dans Pharmakos, maintenant que c’est crée oui. Et en même temps ça fini par « vous regardez quelqu’un danser ». Là, j’ai parlé des grandes lignes mais il y a des figures qui sont plus secondaire et pourtant présentes. La figure de Salomé, par exemple, a été récupérée dans notre héritage cultuel, on en a fait vraiment la danseuse qui subjugue, réceptacle de tous les fantasmes sexuels. Pour René Girard, c’est une enfant et du coup innocente et en même temps, c’est bien elle qui danse, qui est l’agent qui va mener Hérode à sa perte. C’est la danseuse qui est là. Il y avait deux liens à faire au plateau : que ce soit elle qui ouvre et ferme le spectacle parce que tout vient de là. Dès le départ, elle pose la question de la danse, de la question du corps sensuel et séducteur, ca pose la question de la théâtralité, du spectaculaire. Tout le spectacle est une danse qui va nous ramener au début. Le spectacle est un reflet de quelque chose qui est cyclique.
L’individu est au centre de ce cycle, il a quelque chose de très humain dans le travail. Et donc de violent. C’est le nerf du sujet. Cette notion de l’inéluctabilité de la violence, elle est au cœur du sujet. C’est une question à laquelle je n’ai pas de réponse mais qui est ce qui est le plus fort : une proposition artistique qui apporte des solutions et un spectacle qui n’apporte pas de réponse.
Dans Pharmakos, il y a la question du destin. Au théâtre, s’il n’y a pas la mort au bout, ça ne vaut pas le coup d’être venu ! (rires) On n’a peut être pas de destinée dans le monde mais on en a besoin au théâtre. Même si elle n’est pas au bout. Mais je ne voudrais pas transmettre ou véhiculer un fatalisme et un pessimisme. Certainement pas. Mais je ne voudrais pas faire croire que j’ai trouvé des solutions. Ca fait de siècles que c’est comme ça et la violence, elle, est toujours là, très très concrète. J’ai l’espoir que de la mettre au théâtre, et c’est ce que font tous les dramaturges, ça joue un rôle de modérateur ou de tempérance. Si on fermait tous les champs de la culture, a priori se serait pire. Les solutions ? La combativité, l’utopie, le militantisme ? En revanche, il y a cette citation de Dostoïevski dans le spectacle : « le monde sera sauvé par la beauté. » Aussi violente que puisse être une histoire, il y a toujours quelque chose à voir avec la beauté, dans la tentative de transformer l’horreur avec quelque chose de beau. De ramener de la beauté, dans des rapports avec des personnages, avec des figures, de créer de l’image. Si cette beauté là, elle parvient jusqu’au public, ça valait déjà le coup.
Propos recueillis par Bruno Paternot
*Ecole National Supérieure d’Art Dramatique. Il en existe 11 partout en France.
* Dans les derniers textes du philosophe, on peut recommander notamment Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, de la pharmacologie (Flammarion, 2010) et Pharmacologie du Front National (suivi du Vocabulaire d’Ars Industrialis par Victor Petit, Flammarion, 2013)
* Pour aller plus loin (et un peu ailleurs) sur la pensée de Girard :
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/la-jalousie-24-rene-girard-shakespeare-et-les-feux
*Le Bouc Emissaire, René Girard, Le livre de poche (1986)